De l’expression des besoins à la réalité : l’approche intelligente d’Ingenio pour la conception de laboratoires: LÉCan 2025
Lors de la conférence SLCan 2025, j’ai présenté une conférence percutante intitulée :
« Du besoin à la réalité : les erreurs de planification qui compromettent l’efficacité instrumentale ».
La présentation a mis en lumière l’écart souvent sous-estimé entre les besoins scientifiques et les réalités architecturales. Forte de plusieurs années d’expérience internationale en conception et optimisation de laboratoires, l’équipe d’Ingenio et de Phytronix démontre comment une véritable collaboration entre scientifiques, ingénieurs et architectes permet d’éviter des erreurs coûteuses et des inefficacités dans les infrastructures de recherche.
Cet article résume les principaux points, études de cas et leçons tirées de ma présentation.
Comprendre l’expression des besoins scientifiques
Pourquoi le langage est essentiel en planification de laboratoire
Étude de cas 1 : Le piège de la ventilation
Étude de cas 2 : Le dilemme du champ magnétique
Étude de cas 3 : La densité d’instruments — Hub, sauveur et tourmenteur
Leçons tirées de laboratoires réels
Comprendre l’expression des besoins scientifiques
La présentation s’est ouverte sur une question fondamentale :
« Comment doit être composée une équipe de conception de laboratoire ? »
Selon moi, une équipe optimale devrait inclure :

- Des architectes, responsables de la forme et de l’organisation des espaces ;
- Des ingénieurs issus de diverses spécialités ;
- Des spécialistes d’instruments et des scientifiques, qui maîtrisent les flux de travail réels.
Ce trio garantit que le vocabulaire scientifique, les contraintes techniques et les processus expérimentaux sont correctement traduits dans les plans architecturaux et mécaniques. Lorsque concepteurs et utilisateurs « parlent le même langage », ils peuvent anticiper les conflits de conception avant qu’ils ne deviennent problématiques.
Pourquoi le langage est essentiel en planification de laboratoire
Une citation de Charles Darwin illustre l’importance cruciale de la communication: « Language is an art, like brewing or baking…. It certainly is not a true instinct, for every language has to be learnt. ».
Les besoins scientifiques sont rarement simples. Par exemple, un chercheur expliquant une procédure de préparation d’urines décrit en réalité une combinaison complexe de besoins en ventilation, en espace, en sécurité et en infrastructure. Sans compréhension partagée, le risque de mal interpréter ces besoins essentiels est élevé.
L’approche d’Ingenio et Phytronix, « Talk the talk and walk the walk », résume parfaitement cette philosophie : des concepteurs qui comprennent la science conçoivent de meilleurs laboratoires.
Étude de cas 1 : Le piège de la ventilation
Le premier exemple concret portait sur la ventilation, un domaine où de simples oublis peuvent provoquer de grands problèmes.
Différents instruments, de la chromatographie gazeuse (GC) aux systèmes ICP, génèrent de la chaleur ou des vapeurs chimiques nécessitant des configurations d’air spécifiques.
Des erreurs de planification peuvent mener à :
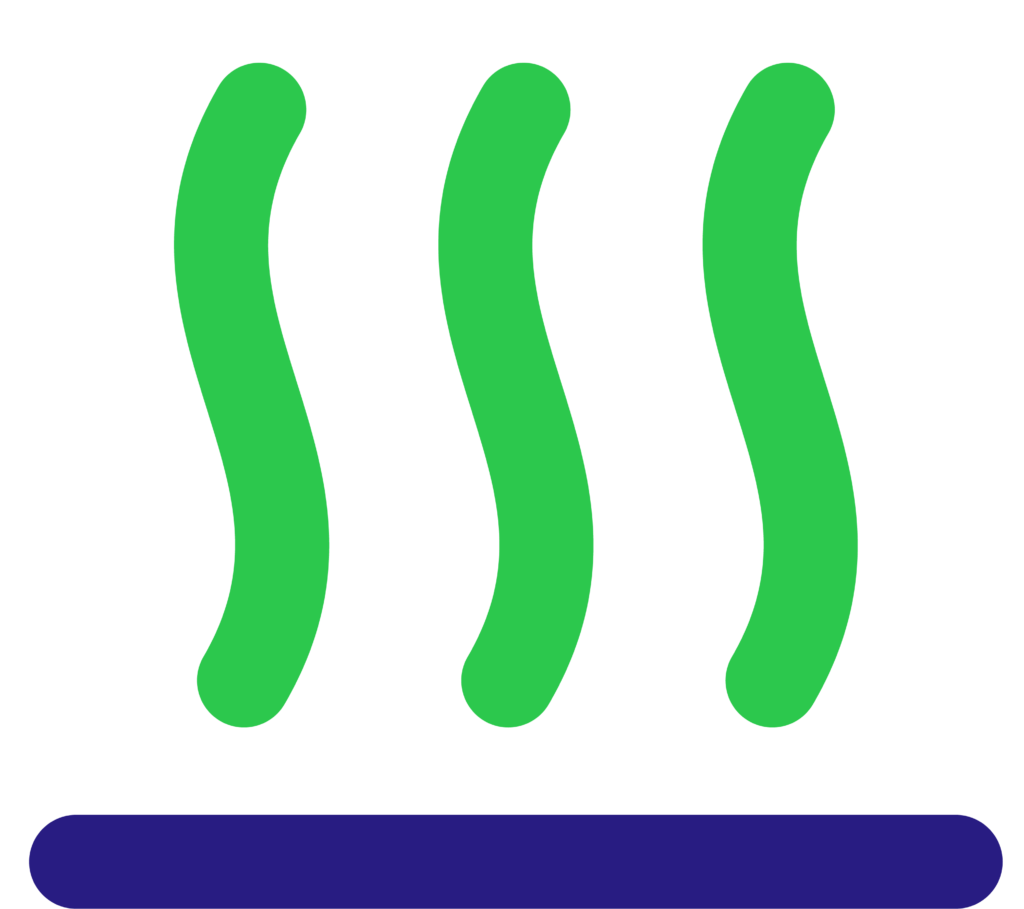
- Des salles en surchauffe ;
- Des risques d’exposition chimique ;
- Des coûts de rénovation élevés après la construction.
L’exemple marquant : le congélateur -80 °C, surnommé avec humour « l’instrument parasite ultime ». Chaque unité rejette de 5 000 à 7 500 BTU/h. Multipliés par des dizaines, ils peuvent saturer même les systèmes de ventilation les mieux conçus.
Une planification stratégique dès le départ évite ces pièges fréquents.
Étude de cas 2 : Le dilemme du champ magnétique
Les instruments tels que les TEM (microscopes électroniques en transmission) sont extrêmement sensibles aux champs magnétiques parasitaires, parfois aussi faibles que 20 à 100 nanoteslas, soit 3 000 fois moins que le champ magnétique terrestre.
Ignorer ces contraintes peut entraîner :

- Des erreurs de mesure ;
- Des instruments inutilisables ;
- Des projets de rénovation pouvant coûter plusieurs millions de dollars.
Ingenio et Phytronix recommande notamment :
- La relocalisation des sources d’interférence ;
- L’ajout de blindage en alliages de mu-métal ;
- L’utilisation de systèmes de neutralisation active de champ;
- Une planification proactive dès les premières étapes de conception.
Ce cas renforce un message clé : l’expertise instrumentale doit être intégrée très tôt dans le processus.
Étude de cas 3 : La densité d’instruments — Hub, sauveur et tourmenteur
Les « hubs » instrumentaux, espaces partagés regroupant plusieurs systèmes complexes, sont de plus en plus populaires pour optimiser les ressources et l’espace.
Nous les décrivons de deux façons bien différentes :
- Le Sauveur : un hub bien planifié, maximisant la collaboration et l’efficacité (électricité, gaz, ventilation, sécurité bien anticipés).
- Le Tourmenteur : un hub surchargé ou mal pensé, devenu rigide et difficile à adapter.

Pour être performants, les hubs doivent intégrer :
- des zones séparées pour éviter les interférences ;
- une réserve de capacité de 20 à 40 % pour de futurs instruments;
- des accès clairs aux services techniques.
Cette section met en évidence que les hubs nécessitent prévoyance et flexibilité afin de concilier efficacité et évolutivité.
Leçons tirées de laboratoires réels
Après des centaines de visites de laboratoires à travers le monde, nous en avons dégagé plusieurs pratiques :
- Réaliser tôt un inventaire complet des instruments, incluant les acquisitions futures (1 à 3 ans).
- Mandater un spécialiste externe pour documenter l’équipement, les scientifiques sous-estiment souvent leur propre installation.
- Considérer la liste d’instruments comme un document vivant.
- Favoriser la collaboration interdisciplinaire avant le début des travaux, afin de s’assurer que les nuances techniques sont comprises.
En fin de compte, la satisfaction et la fonctionnalité d’un laboratoire dépendent de la qualité de la traduction des besoins en solutions concrètes.
Conclusion
La présentation SLCan 2025 s’est conclue par un message clair :
« En comprenant mieux les scientifiques et leurs besoins spécifiques, il est possible d’améliorer la conception des laboratoires et leur efficacité. »
Un laboratoire bien conçu ne repose pas uniquement sur l’esthétique ou l’équipement: il s’agit de combler les écarts de communication, d’encourager la compréhension mutuelle et d’aligner la conception sur la finalité scientifique.
Prêt à transformer votre laboratoire, du besoin à la réalité ?
Communiquez avec Ingenio dès aujourd’hui pour discuter de votre projet de conception ou de rénovation, et assurez-vous que chaque détail scientifique se traduise en efficacité réelle.